« Bientôt, je n’aurai plus honte d’être inutile »
Kibrom (1), 39 ans, est Érythréen. Il a fui son pays il y a deux ans vers l’Éthiopie voisine. Aujourd’hui en transit, il attend son visa pour les États-Unis. Les années de prison, les interdits religieux, la pression de la dictature l’ont jeté sur les routes. Mais c’est avant tout la volonté de ne plus vivre dans la honte qui l’a poussé à devenir un migrant. A lire sur Terraeco
« Après le lycée, j’ai été enrôlé de force dans l’armée, comme la majorité des hommes en Érythrée. Aujourd’hui, le gouvernement ne recrute plus seulement les jeunes. Il embrigade ceux de plus de 60 ans, les vieillards, n’importe qui. Quand on devient soldat, on n’a pas le droit de travailler. Pour moi, cela signifiait la honte. Car je n’avais plus les moyens de soutenir ma famille. Pour nous, les garçons, c’est nous retirer notre rôle. Alors j’ai commencé à travailler comme couturier dans un atelier clandestin que j’avais moi-même aménagé. J’ai été découvert et envoyé directement à la prison Track-B à Asmara. J’y suis resté dix mois.
Peu de temps après, ils ont compris que j’étais pentecôtiste (mouvement protestant apparu aux États-Unis à l’époque de la guerre de Sécession, ndlr). Cette religion est interdite en Érythrée. Seuls les musulmans, les chrétiens orthodoxes, les catholiques et les luthériens sont acceptés. Au bout de quatorze mois, j’ai renoncé à mes croyances pour qu’ils me libèrent. A ma sortie de prison, ils m’ont fichu un livre entre les mains, sur l’histoire de l’Érythrée. Un manifeste en trois tomes. Ils m’ont forcé à le distribuer à mon entourage et à en faire la propagande. J’ai refusé. Et je suis retourné en cellule. Pendant un an, j’étais menotté à un barreau. Vous voyez, j’ai encore les marques sur les poignets.
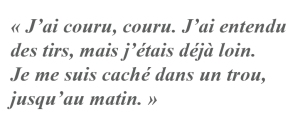 J’ai été transféré d’Asmara vers la prison Hadjib à Massaoua. La plus redoutée du pays. Le camion transportait 47 détenus. Il faisait nuit. Lorsqu’il s’est arrêté pour nous faire descendre, j’ai pensé que les soldats n’auraient pas le temps de prendre leurs fusils et de les armer. C’était maintenant ou jamais. Alors j’ai couru, couru. J’ai entendu des tirs, mais j’étais déjà loin. Je me suis caché sur la côte, dans un trou, jusqu’au matin. J’ai réussi à contacter un de mes cousins, qui a pu me rapatrier à Asmara. J’étais un homme mort si je restais en Érythrée. J’ai appelé ma sœur, qui vit aux États-Unis. En quelques jours elle m’a trouvé un passeur pour fuir vers l’Éthiopie. Elle a payé 2 000 dollars (1576 euros).
J’ai été transféré d’Asmara vers la prison Hadjib à Massaoua. La plus redoutée du pays. Le camion transportait 47 détenus. Il faisait nuit. Lorsqu’il s’est arrêté pour nous faire descendre, j’ai pensé que les soldats n’auraient pas le temps de prendre leurs fusils et de les armer. C’était maintenant ou jamais. Alors j’ai couru, couru. J’ai entendu des tirs, mais j’étais déjà loin. Je me suis caché sur la côte, dans un trou, jusqu’au matin. J’ai réussi à contacter un de mes cousins, qui a pu me rapatrier à Asmara. J’étais un homme mort si je restais en Érythrée. J’ai appelé ma sœur, qui vit aux États-Unis. En quelques jours elle m’a trouvé un passeur pour fuir vers l’Éthiopie. Elle a payé 2 000 dollars (1576 euros).
Cinq jours plus tard, j’ai reçu un coup de téléphone. Un homme m’a donné par code un lieu de rendez- vous. Nous étions cinq candidats au départ, trois jeunes garçons et deux hommes. Nous sommes partis de nuit à pied en direction de l’Éthiopie. Je ne sais pas ce qui m’a poussé à avoir confiance en ce passeur. L’Éthiopie me paraissait sûre. Les réfugiés qui passent par le Soudan ou le désert du Sinaï, en Égypte, sont en général vendus par leurs “ sauveurs ’’ à des trafiquants qui emprisonnent, torturent et demandent des rançons aux familles. Nous avons marché seize jours. Il fallait éviter toute personne, se méfier de tout le monde, car même les fermiers peuvent être des espions déguisés.
Nous avons enfin atteint la frontière. Il fallait traverser la rivière Mereb. Nous avons rampé sans faire le moindre bruit. Comme des animaux. Pendant des heures. Peu de gens parviennent de l’autre côté. Si les soldats aperçoivent les fugitifs, ils n’hésitent pas à tirer. Mais si les civils atteignent l’autre rive, les gardes-frontières éthiopiens les protègent et prennent pour cible les soldats érythréens. L’Éthiopie est encore officiellement en guerre contre l’Érythrée.
Une fois arrivés à Rama, dans le nord du pays, nous nous sommes présentés aux officiers. Ils ont posé des questions et nous avons dû mentir : “Avez-vous été dans l’armée ? Avez-vous participé au conflit contre l’Éthiopie ? Avez- vous tué des Éthiopiens ? ’’ Nous avons tous répondu “ non ’’, sans grande conviction. J’ai ensuite été amené au camp de réfugiés d’Adi Arush et j’ai obtenu rapidement la permission de venir à Addis-Abeba pour travailler. Avoir une vie normale, si on peut dire. J’ai trouvé un petit logement dans la banlieue sud de la capitale, où vit la communauté de mon pays. Mais ici tout est cher. Faire ses courses, se loger… Le loyer est de 1 500 birrs par mois (60 euros, ndlr).
Heureusement, je partage la maison avec un autre réfugié. J’ai trouvé un travail de couturier, mais je suis sous- payé. Les Éthiopiens savent qu’ils peuvent abuser de nous, alors notre salaire ne vaut rien. Je ne compte pas rester dans ce pays, où ma vie n’a pas de sens. Je veux aller aux États-Unis. Ma femme… la seule femme que j’ai connue. Depuis vingt ans, elle m’a toujours soutenu et, aujourd’hui, c’est elle qui va encore m’aider. Nous nous sommes mariés assez jeunes ; j’étais déjà dans l’armée. Elle a fini par demander un visa pour l’Afrique du Sud. C’est difficile d’obtenir un laissez-passer pour quitter le pays. Les autorités exigeaient mon accord. J’ai expliqué que, en tant que militaire, sans salaire, je ne pouvais subvenir aux besoins de ma femme. Le prétexte était suffisant. Le gouvernement l’a autorisée à faire sa vie ailleurs.
D’Afrique du Sud, elle a réussi à partir au Mexique. Elle a franchi la frontière illégalement vers les États-Unis. Maintenant, sa situation est régularisée. Étant son mari, je peux demander à la rejoindre. Là-bas, je vais travailler. Travailler dur pour ma famille restée en Érythrée. J’ai encore mon père, qui est handicapé, et je dois lui venir en aide. Je reprendrai mon rôle d’homme de famille. Je n’aurai plus honte d’être inutile. Si je le pouvais, je rentrerais en Érythrée. C’est un pays fabuleux, avec un peuple fabuleux. Mais la politique n’est pas près de changer. Et je n’ai pas confiance en l’espoir. »
Propos recueillis par J.B.
1) Le prénom a été modifié.
